Je ne suis pas particulièrement féru de musique lyrique, sauf bien sûr quand il s’agit de Vivaldi, Mozart, Schubert parfois ; d’autres encore certes.
Là : compositeurs (de moi en tout cas) peu connus.
Mais c’est que ça se passe en Suède, au XVIIe siècle, à la cour de Charles XI…
 |
| NB - Bohuslän |
Le CD s’appelle Northern Light – pourquoi pas ? –, avec comme sous-titre : Echoes from 17th-century Scandinavia. Interprète : Lucile Richardot, , accompagnée par Sébastien Daucé avec l’Ensemble Correspondances. C’est chez Harmonia Mundi.
Bon, mais pas de titre en anglais. On a du suédois, de l’allemand, du latin ; pièces de Franz Tunder, Vincenzo Albrici, Johann Christoph Bach (grand-oncle de…) – d’autres…
Pour ce qui est de lumière nordique, Charles XI (1655-1697) – au règne duquel donc les morceaux du CD sont attachés – monarque absolu, fut appelé le Soleil du Nord – réplique septentrionale de Louis XIV. (Le livret du CD parle aussi de « sol inocciduus », le soleil qui ne se couche jamais, en référence au solstice d’été.)
 |
| NB - Bohuslän |
On voit dans la culture musicale de la Suède de l’époque un lien avec la France ; on n’en est pas encore à la francophilie d’un Gustave III, rompant avec l’aversion que le français inspirait à un Charles XII. La Suède, dans le domaine musical, s’ouvre aux autres cultures ; Huub van der Linden (traduit par Martine Sgard) écrit dans le booklet du CD : « Si la cour de Louis XIV avait élaboré un style musical à la française, reflétant l’apparat royal de l’identité “nationale”, la cour suédoise se présentait délibérément comme un carrefour de musiques et de musiciens européens. Cette ouverture musicale s’inscrivait dans la continuité d’une tendance initiée par la reine Christine de Suède, qui, au milieu du XVIIe siècle, avait fait venir à Stockholm des musiciens italiens et de nombreux instrumentalistes à cordes français. »
 |
| NB - Bohuslän |
On retrouve donc l’énigmatique reine Christine (que Patrick Reumaux laisse ses personnages passablement maltraiter dans ses derniers livres…)
Or le tableau de Savery, auquel Martin Fahlén a consacré son livre, est peut-être passé entre les mains de cette dernière. Dans Le tableau de Savery, justement, on lit, page 42 :
« Les œuvres d’art qui arrivaient au château [de Rodolphe II] résultaient de transactions liées aux évolutions diplomatiques et de vols. On envoyait en mission des ambassadeurs et des artistes pour assembler des objets. Les magnifiques œuvres du palais relevaient à la fois de la vie privée de l’empereur et de sa propagande. Mais sa diplomatie échoua et la Guerre de Trente Ans entraîna le
pillage des œuvres à Prague. Démantelée, la collection passa de mains en mains de différents souverains. C’est ainsi qu’en 1648, des militaires suédois acheminèrent un grand ensemble de prises de guerre à la reine Christine. (…) Le Vertumne d’Arcimboldo faisait partie du lot [et de la récente exposition au Louvre à Paris], et on peut le voir aujourd’hui au château de Skokloster. »
Le monde est petit, pas ? J’avais pensé à un moment intituler la traduction du livre de Martin Fahlén Paradis perdus/retrouvés, notion (du Paradis) qu’on retrouve dès la première strophe de la première pièce du CD (en suédois, ce morceau de Franz Tunder) :
« Ack Herre, låt dina helga änglar / Uti min dödsstund föra min själ, I Abrahamas sköte föra. » (« Ah, Seigneur, fais que tes anges saints, / À l’heure de ma mort, accompagnent mon âme / Dans le sein d’Abraham. »)
Nils Blanchard








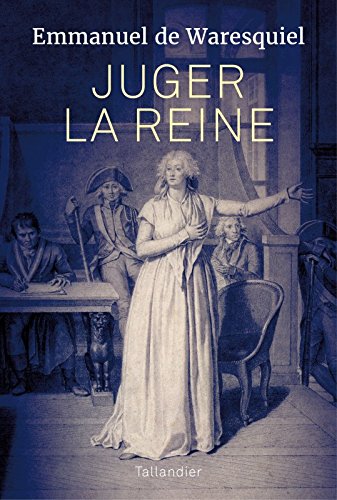









JPG_versionAK.JPG)
