Une petite série de billets de ce blog met les fantômes en tête de gondole, pour ainsi dire. La dernière fois, c'était en lien avec la nudité. Là, ce serait plutôt du côté des lieux qui plient face à la mercadence, ou à une certaine modernité ?
(Oui, quand j’aurai de la place, je rajouterai l’étiquette « vieux con ».)
Il a déjà été fait mention dans ce blog du livre Le pays où l’on arrive un jour, paru aux éditions Invenit, avec c’est vrai des illustrations de Julie Faure-Brac, avec aussi quelques pépites.
Ainsi il me faut citer la fin du texte de Roland Frankart, qui lui-même cite Hubert Juin (page 11) :
« Dans bon nombre de ses romans, un lecteur familier de la région peut situer certains de ces lieux [dhôteliens, donc] (…). Dans d’autres, c’est moins évident (…) Sa cartographie romanesque [à André Dhôtel] ne coïncide que très approximativement avec la réalité de son pays ardennais. (…)
L'Ardenne d’André Dhôtel n’est plus vraiment celle de notre XXIe siècle (…). Il y a cinquante ans, Hubert Juin écrivait déjà : “Le lecteur d’André Dhôtel remarquera qu’en quittant le livre pour l’Ardenne réelle, il découvre un paysage défiguré. Il en va ici comme partout : l’avidité mercantile souille la parole des lieux et détruit la géographie du poème. Il n’empêche qu’un pays, qu’une contrée, qu’une ville mettent longtemps à mourir. On les jette bas, on les bouscule, on les modifie, mais il suffit d’un accord furtif de l’air et du regard pour que le site d’aujourd’hui soit envahi par le fantôme (…) du site d’hier.” »
Nous y voilà. Et l’histoire parfois (j’entends par là celle avec un grand H) est aussi histoire de discussion avec des fantômes.
C'est ce qui apparaît dans le livre d’Emmanuel de Waresquiel, Juger la reine (Tallandier, 2016), sur le procès de Marie-Antoinette.
À la fin du livre, dans la postface – quelle mouche le pique ? – voilà que l’auteur évoque les lieux d’archives (pages 278-279) et :
« Aujourd’hui, la partie contemporaine des Archives nationales est conservée dans la banlieue parisienne, à Pierrefitte-sur-Seine. (…) On prend la ligne 13 du métro et on débouche en face des bâtiments de l’université de Saint-Denis. Ah ! Les banlieues d’autrefois. Lorsque j’étais enfant (…). Cela ressemblait encore à ce qu’on lit dans la Recherche, lorsque Robert de Saint-Loup va rendre visite à sa maîtresse dans le pavillon de pierre meulière d’un village dont on ne sait pas le nom. (…) Des poiriers, des pommiers, des cerisiers, tout un univers de maraîchage et d’horticulture où l’on devinait comme la trace de ces folies anciennes qui servaient de villégiatures aux financiers ou aux maîtresses du roi.
À Pierrefitte, cette banlieue-là, de pavillons et de jardins a disparu. »
Eh, que voulez-vous. Financiers et maîtresses, titre d’un roman, non ?
De Waresquiel poursuit : « Des séries de cubes et de rectangles. On a quitté les confins improbables des banlieues de Gracq à demi envahies par la forêt. »
 |
| NB - Haguenau, juin 2025 |
Proust, Gracq, bien sûr. L’auteur aurait pu évoquer aussi Le ciel du faubourg, d’André Dhôtel (eh ! Ne retombons-nous pas sur nos pattes?)
Il est un ouvrage vaguement collector peut-être, compte-rendu d’une série de conférences lors des journées Littérature en Lagast ; je parle du Cahier n° 8, consacré à André Dhôtel bien sûr (en 2016) (où je commis quant à moi de longues réflexions sur la géographie passablement erratique de l’auteur). Philippe Blondeau, lui, évoqua le faubourg, dans un texte de « tentation de définition d’un lieu dhôtelien ». On y lit (entre autres, entre autres…) page 63 :
« Lieu privilégié d’un certain égarement, le faubourg se caractérise, plutôt que par une situation précise, par une poétique des lieux, un certain sentiment d’étrangeté, l’impression d’être ailleurs, là où les repères de la ville s’effacent ou se brouillent. »
Quelle impression aujourd’hui. Cubes, rectangles et fantômes ; un tout autre égarement.
Mais quant aux fantômes, et dans sa postface, toujours (page 286), Waresquiel y vient, ou presque, après nous avoir promenés dans différents lieux d’archives :
« Dans l’introduction à son Histoire de France, Michelet convoque toute la galerie des rois et leur parle comme s’il les voyait. On peut dialoguer avec des ombres. (…) Ce sont des conversations utiles. On y apprend des choses sur le temps qu’il fait, sur le temps qui passe et sur celui qui ne passe pas (…) »
Nils Blanchard
Ajout. On en avait un peu parlé: publication en Suède d’une nouvelle traduction des Liaisons dangereuses de Laclos.
Bon, mais Jenny Högström de noter (dans le Göteborgs Posten du 28 juin :
« (...) på det stora hela har Jan Henrik Swahn lyckats med den äran med sin nyöversättning till svenska – den första på 70 år – utan att det låter krångligt eller konstlat. Han har ju tjuvtränat med att översätta Madame de Staël. »
« (...) dans l’ensemble, Jan Henrik Swahn [le traducteur] a franchi avec les honneurs l’étape ded cette nouvelle traduction – après 70 ans – sans qu’il y ait quoi que ce soit de compliqué ou d’affecté. Il est vrai qu’il s’est entraîné en traduisant Madame de Staël. »
Et de Madame de Staël, E. de Waresquiel parle, évidemment, dans son livre…

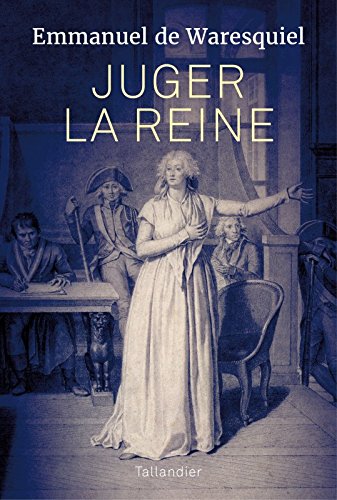


JPG_versionAK.JPG)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire