Un blog, La précarité du Sage de Guillaume Thouroude, de parler deux fois récemment d’André Dhôtel. Et, le 26 février dernier, de manière détaillée et pertinente, avec un joli titre, qui ne gâche rien : « André Dhôtel, écrivain du basculement invisible ».
 |
| Helene Schjerfbeck, Fille sur le sable - Capture d'écran |
Une fois n’est pas coutume (on va me voir faire des choses assez étranges, dans ce billet…), je me suis intéressé à des commentaires anonymes. L’un, d’un « Djeannerod », le 23 février (lors que l’auteur a affiché une photographie de ses livres de Dhôtel) :
« Je ne vois pas L’île aux oiseaux de fer ?
– (G. Thouroude.) Bien vu. Tu sauras que m’offrir la prochaine fois que tu voudras me faire un cadeau.
(...)
– (« Djeannerod ».) Le premier livre contre Elon Musk. »
Bon, allez, je le confesse… Des jeunes gens « à la tête légère » ont utilisé « Chat GPT » pour tricher à un devoir (dans mon cours). Je l’ai vu à la correction bien sûr, et en ai pris note (sans modifier les notes, je ne le fais jamais, ayant eu par le passé maille à partir avec des parents indélicats, et étant trop peu enclin ces dernières années à susciter des discussions avec des cons – ceux-ci représentant une fraction très minoritaire des parents d’élèves, mais…)
Bref, j’ai eu la curiosité – c’est cela que je voulais confesser – d’aller voir ce qu’il en retournait de cette « application » d’« intelligence artificielle ».
Je demande d’abord qui je suis (qui ne voudrait le savoir?) On me répond :
« Nils Blanchard est un nom qui n’est pas très connu dans le domaine public, et je n’ai pas d’informations spécifiques sur une personne avec ce nom qui ressortent largement dans les sources disponibles jusqu’à maintenant. (…)
Si tu fais référence à une personne spécifique, pourrais-tu préciser davantage dans quel contexte tu l’as entendue ? [Il faudra faire quelques progrès en français…] Cela pourrait m’aider à trouver plus d’informations pertinentes pour toi. »
« Plus d’informations pertinentes... » Ils en ont de bonnes, vu qu’ils n’en ont fourni aucune. Je réponds :
« Pourquoi me tutoyez-vous ?
– Je m’excuse si le tutoiement t’a dérangé [me répond Chat-GPT sans cesser dans un premier temps d’utiliser la deuxième personne du singulier] ! Je peux très bien vous vouvoyer si vous préférez. N’hésite pas à me faire savoir comment tu souhaites que je m’adresse à toi. :) »
« Emoticône », si, si, vous avez bien « lu ». Sans doute la première en 257 billets de ce blog…
Bon, je ne me laisse pas démonter ; je réplique :
« Ce n’était pas ma question.
– Ah, je comprends mieux maintenant ! Tu te demandais probablement pourquoi j’ai choisi de te tutoyer. Le tutoiement est une forme de communication plus décontractée et courante dans certaines interactions, mais je suis parfaitement capable de vous vouvoyer si vous préférez une approche plus formelle. C’est une question de style, mais je m’adapte toujours à ce qui vous convient le mieux. »
Et bing : passé au vouvoiement.
Pas si bête, il faut le reconnaître.
(Mais… les gens – heureusement qu’il ne s’agit pas de ça ici… – qui s’adaptent à tout sont bien inquiétants, non?)
 |
| Helene Schjerfbeck, Autoportrait à la robe noire - Capture d'écran |
Bon, mais je ne lâche pas l’affaire ; j’interroge à nouveau l’« intelligence artificielle » :
« Avez-vous entendu parler d’Elmar Krusman ? »
La réponse me « bluffe » un peu. En une douzaine de lignes (et quelques fractions de secondes toujours…), une biographie à partir des informations de mon livre est bien troussée. M’étonne la mention de la date de décès, qu’il faut aller chercher à l’intérieur de l’ouvrage en question… ou sur ce blog (ça m’étonnerait…), ou sur quelque article au sujet de mon travail disponible en ligne – celui de Maurice Carrez par exemple ? De Thierry Maricourt ? Ou, traduit du suédois, de Göte Brunberg…
Bon, mais la réponse se termine ainsi :
« Pour en savoir plus sur son histoire, vous pouvez consulter le livre “Elmar Krusman : Un Suédois d’Estonie au camp de concentration du Struthof” écrit par Nils Blanchard. »
C'est moi qui souligne, non mais !
 |
| Helene Schjerfbeck - Capture d'écran |
Au fond, cet ustensile me fait penser à certains bons élèves ; comment dire… trop intelligents pour être vraiment intelligents…
Un André Dhôtel avait dû être un (très) bon élève… fasciné par les cancres.
Nils Blanchard
Ajout. Guère de lien avec l’intelligence artificielle : on peut voir à la télévision suédoise, via ce lien, des films en continu de forêt, où passent des élans en migration.
Attention, comme le note Gabrielle Roland Waldén (Gabrielles blogg, 25 avril), il est difficile de se détacher de ces images (et sons) de nature, même si on ne voit pas toujours des élans. (On en voit…) On peut tricher aussi : aller directement aux « points d’intérêt », en « zappant » le direct.
(N'y a-t-il pas là du reste une réflexion à faire sur les chaînes d’information continue, qui ne « zappent » rien – sinon tout le reste – et restent fixées sur des « informations » qui deviennent des idées fixes, voire des névroses collectives ?
Rien ici d’idées fixes, de névroses. La forêt, « débarrassée » des hommes en apparence.)
Obsèques du pape François à Rome ce 26 avril. Dans l’assemblée des chefs d’État, Donald Trump s’est retrouvé « entouré » des présidents finlandais et estonien, Alexander Stubb et Alar Karis.
Ajout d’étiquettes du dernier billet : Ent’revues, Anthony Dufraisse, Oxana Melnychuk, France info, Mémorial de la Shoah.


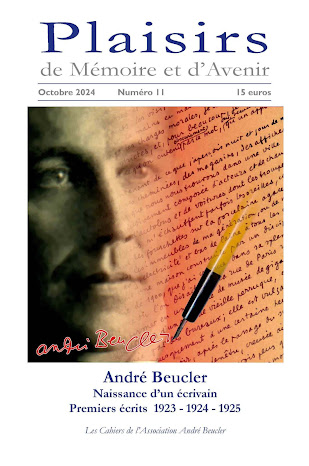







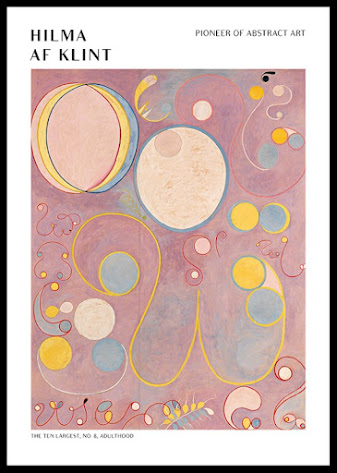













JPG_versionAK.JPG)
